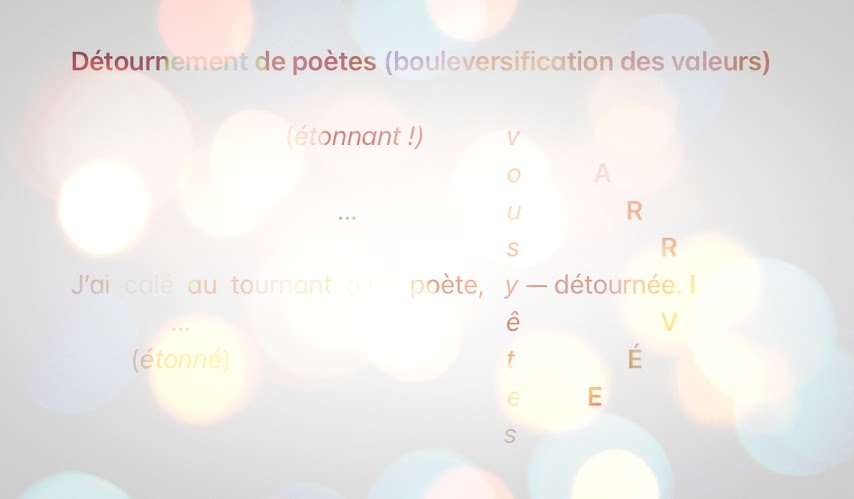|
| Denys l’ancien, l’épée de Damoclès, 1812, Richard Westall (1765-1836) |
I. D’un ostracisme culturel, lourd, supposé, en poésie contemporaine
L’expérience (au sens de quantité de réalité accumulée par un individu) enseigne bien des choses, parfois à se méfier, mais toujours à examiner les raisons exprimées pour ou contre, les motivations qui jalonnent le parcours de l’individu que l’on est incontournablement. In fine, c’est la qualité de la réception que les autres lui réservent et réservent à ses actes, à ses œuvres, qui se révèle à lui, publiquement ou non.
Dans la société francophone de la poésie française (j’écarte d’emblée celle qui ne serait fondée que sur les réseaux de connivence et l’entresoi), le matériau premier pour juger d’une présentation, d’une œuvre et des valeurs qui la portent, ce sera, il me semble, le gris de la littérature, les poèmes, certaines lettres et courriels qui les accompagnent, le « noir sur blanc ».
En ma qualité d’individu et d’écrivain, j’ai toujours été bien reçu à l’entrée virtuelle des multiples cercles poétiques où j’ai présenté mon projet, des bribes de mon œuvre poétique, des poèmes. Si parfois, de rares fois, l’échange ne s’est pas poursuivi cordialement ou sans incompréhension, j’en suis le premier responsable. Parfois, mon impéritie ou mon manque de préparation, ma verdeur ou mon impatience, en des cas encore plus rares ma colère ou une forme de penchant à faire table rase, auront tristement balayé les réserves, les préjugés utiles, voire le rejet tout légitime qu’on opposait à mes poèmes pas toujours pertinents, pas toujours destinés avec motivation, ni sincères ni même bons, même à mes yeux.
Mais passons sur ces incartades de débutant, et entrons plus avant dans le sujet, car je ne veux rien moins que le lecteur ne prête à cette lettre ouverte une quelconque tournure ironique.
Au-delà de la présentation d’une œuvre à un comité de lecture, que ce soit pour une revue en ligne ou pour une maison d’édition, et au-delà du premier refus de ce comité de lecture, il y a l’échange qui leur fait suite, le cas échéant ; et le motif du refus, si le comité veut l’exprimer.
1. Le cas de non-réponse
Si rien ne fait suite à la demande de précisions de l’auteur, on retiendra que c’est l’indifférence qui a succédé à sa demande. Dans certains cas l’indifférence est culturelle, dans d’autres elle est professionnelle.
- Indifférence culturelle : dans le cas d’une réponse qui ne vient jamais car vous étiez prévenu par avance que, si « dans deux mois », vous n’aviez pas reçu de réponse, vous pouviez considérer qu’elle équivalait à un refus.
- Indifférence professionnelle : même cas de non-réponse, cette fois en raison d’une faiblesse de gestion, dans certains cas où le temps manque au secrétariat sous pression, débordé, etc., ou à la suite d’un oubli, d’une négligence.
Comme lors d’une entrevue d’embauche qui ne porte pas ses fruits, le demandeur est en droit de questionner les raisons du refus, si celles-ci n’ont pas déjà été explicitées. Dans le cas où un échange fait suite au refus de publication, un débat peut s’installer. Et ici, comme dans l’entreprise, le comité de lecture peut exprimer ses motifs en les détaillant.
2. Le cas de réponse négative argumentée
À partir de ce stade, l’indifférence culturelle peut encore donner de la voix. Par exemple elle peut avancer ses « goûts personnels » mentionnés évasivement, sans plus de précisions. L’indifférence peut aussi porter un masque, si elle ne veut pas explorer la palette de ses propres valeurs, en répondant par exemple : « N'hésitez pas à lire vos contemporains publiés en revue ou par les maisons d'édition et ayez l'audace. » Ou : « Ce que vous m’envoyez est certes très sympathique, un bel engagement et un bel amour de la poésie, mais je l’ai déjà lu nombre de fois. »
À multiplier les confrontations à l’indifférence culturelle, l’auteur, s’il consent à persévérer comme un poème persiste dans le temps s’il n’est pas qu’éphémère et perte de soi, comprendra que c’est en réinventant ses angles d’approche qu’il en apprendra un peu plus sur le phénomène de la poésie contemporaine, mais surtout pas en suivant des conseils pour lui absurdes, tels que : « Je pense que si vous osiez vous défaire de la poésie classique, celle que nous apprenons à l'école, et avec un peu de travail, car vous avez la fibre poétique, vos textes seraient reconnus par les poètes, revuistes et éditeurs contemporains français. » En effet, pourquoi imiterait-il ce que les autres font, tandis qu’on lui reproche, à tort ou excessivement, de se conformer à un modèle ?
C’est aussi à partir de ce stade que l’interlocuteur du poète (interlocuteur qui lui-même est souvent poète) va, plus ou moins finement, plus ou moins consciemment, mais toujours volontiers, exprimer ses valeurs, les valeurs poétiques qui ont dicté son refus face à ce que le poète veut défendre, c’est-à-dire ses mots et ses pensées, ses conceptions et son existence vivante. Les valeurs qui portent le refus de publier de la poésie contemporaine versifiée et rimée s’expriment typiquement dans un refus qui commence par expliquer la positivité de ce qu’elles veulent publier, de ce qu’elles publient, sur le mode du « comment pas », du « pas comme cela ». Par exemple : « Nous avons décidé de ne pas publier vos textes car ils ne correspondent pas à ce que nous souhaitons publier. » Ou : « Je suis désolé, mais ce n’est pas pour nous. » Nous sommes là, apparemment, au point de de plus grande acuité de la liberté d’indifférence.
Si alors l’auteur a suscité plus de franchise de la part de l’interlocuteur qu’il sollicite, il le verra aborder plus franchement les valeurs qui règnent sur sa conception de la poésie. Cette franchise, que le poète appelle et qu’il remercie malgré la possible « brutalité » qu’il y rencontre, va lui apprendre, à longueur de courriels et de réponses, que la conception de la poésie qu’on lui prête et qu’il défend volontiers, sans toutefois que les deux points de vue se confondent, est rarement la bienvenue dans le monde des revues et des éditeurs, qu’elle n’est ni vraiment dominante ni plébiscitée, ni encouragée ni publiée, et qu’elle suscite une réprobation assez répandue. On lui écrira quelques fois une réponse qui développe l’argument du « comment faire », qui n’explique pas encore le « pourquoi du comment », mais avance quelques pions instructifs pour situer l’interlocuteur, par exemple : « Nous publions essentiellement de la poésie non rimée, non rythmée, de la poésie qui explore de nouvelles possibilités autour du travail de la langue. Et nous n'avons pas rencontré cela dans vos textes. » Ou encore : « Les vers, les rimes, ce n’est plus possible. La poésie doit être un jaillissement, une immédiateté. Ça doit surgir. »
3. Le soupçon de l’ostracisme
Une poésie contemporaine, née d’un poète contemporain, une poésie originale, non plagiée, qui ne passe pas son temps à « compter » ni à « faire sonner », ne comptera pas plus demain dans les poèmes vers-libristes de ses contemporains pour vérifier si le nombre de non-vers de l’un correspond à tels autres plus anciens, si leurs syllabes non-comptées ressemblent à telles autres, si la disposition des non-rimes, ici, a déjà été explorée là. Le poète dit « classique » n’est pas non plus celui qui toujours compte, découpe et sonne. Quelle absurdité de ne plus jamais compter ; mais quel scandale de réduire le vers régulier à un comptage. Qui compte, finalement, dans cette affaire ? Ceux qui passent leur temps à nier ce qui est compté parce que c’est dénombrable, ou bien ceux qui ont appris à compter avant de s’atteler au reste ? Qui rime, finalement, dans cette affaire ? Ceux qui s’arriment à l’idée que rimer est la faillite de toute poésie contemporaine, ou ceux qui font rimer leurs vers à quelque musique qui traverse leur existence et celle de quelques autres ? Qui « explore » ce qui peut être exploré, et qui ne le fait pas ? Qui « travaille » la langue, et qui ne le fait pas ? Qu’est-ce qui peut bien « surgir », et qu’est-ce qui s’embourbe ? Y a-t-il, du côté de la « poésie contemporaine », une volonté d’émancipation de tout aspect traditionnel, de tout droit à l’oisiveté du langage, de toute culture de soi ? Cette volonté se peut-elle sans arrière-pensées, sans aucun humour et sans aucune forme de recul ? Repose-t-elle sur une intolérance à la combinaison des sons, au jeux rythmiques, aux contraintes qui permettent de s’en libérer ?
Pendant qu’une bonne partie de la philosophie combat la technique machiniste moderne, la poésie contemporaine combat la conception technique de la poésie ancienne.
Il ne s’agit plus du tout d’une liberté d’indifférence, mais de valeurs qui expriment activement le refus de la poésie rimée, versifiée. On l’a exprimé dans un refus de la poésie apprise à l’école. Mais quel mal y a-t-il à apprendre de la poésie à l’école et, éventuellement, à s’en souvenir ? Le ressentiment des classes irait-il si loin, viendrait-il de si loin ? De tels complexes me paraissent dangereux. Je préfère seulement les effleurer ici, mais il faudrait y venir si le malentendu croissait.
On a cru voir aussi, dans cette « forme » de poésie (parler de « forme » est très réducteur), un rappel niais et innocent des formes passées, mais rien n’autorise à préjuger de la teneur, de l’innocence ou de la folie créatrice d’un poème, d’après le seul prétexte formaliste et technique « antivers » et « antirime ». Un tel interdit, jeté sur le style, devrait faire l’objet d’une remise en question rigoureuse de la part des militants réfractaires qui n’ont peut-être pas appris le savoir-faire qui le constitue. Il y a au moins autant de mièvrerie, de niaiserie, à ériger en dogme son inexpérience d’un style parmi d’autres, qu’à chanter maladroitement son goût immodéré pour les chatons et les bonbons.
On a aussi voulu dynamiter l’idée ancienne de forme et de sens, de musique et d’image (c’est une fois de plus réducteur) parce que le rythme et la beauté appartiendraient à un passé révolu, haï en raison du sens supposé de l’histoire et de la désertification de l’esprit, la « mort de Dieu », qui interdiraient la régularité du vers et les jeux d’assonances. Il faut reconnaître que si nous étions tous soumis à une seule vision pessimiste de la condition humaine, récuser une certaine poésie classique appartiendrait aussi au pessimisme et à la soumission des esprits, toutes choses qu’une telle vision prétendait pourtant combattre.
Quelques contemporains ont essayé l’alexandrin : Jacques Réda, William Cliff, quelques autres… guère plus.
4. Conclusion
On me fait comprendre très clairement que la poésie classiciste, parée de vers, de rimes, tous ces alexandrins parfaits, ces beaux sonnets et ces quatrains élégants, ne sont plus du goût des contemporains. Ces poèmes rappellent-ils, à ces nouvelles poétesses et nouveaux poètes, la récitation des écoles, le bon Dieu mort et le rythme des armées qui marchaient sur des cadavres ? Je réponds que la beauté est toujours autre, que le travail de la langue est universellement réparti dans tous les poèmes, et surtout que leur censure ne passe pas inaperçue.
Tous les anti- commencent à peser sérieusement sur la poésie contemporaine. Il ne suffit pas de faire un pas de côté à gauche ou à droite pour réfuter un pas dans une autre direction, ni pour prétendre à la « nouveauté ». Cela convient à ceux qui inversent les valeurs depuis leur bureau bien ordonné avant d’embrasser leurs enfants qui rentrent du cours de danse et de tennis tout en réservant pour le soir même une table pour quatre personnes au restaurant. Il ne suffit pas de se réclamer, comme dans certains cas, d’une volonté revendiquée de rejoindre la poésie originaire pour faire oublier que toute origine doit être située. Dans le cas contraire, nous courons le risque de perdre de vue que s’exerce une nouvelle espèce de barbarie métaphysique. Si, après tout, on a bien le droit de ne versifier ni rimer, on ne doit pas interdire pour autant la représentation d’une poésie ni de ce qu’elle est au seul motif qu’elle ressemble à ce qu’elle est ; on ne doit pas lui interdire de faire ce qu’elle peut, sous prétexte qu’on ignore quel pouvoir la poésie peut avoir sur les mentalités (ou bien il ne reste qu’à interdire la littérature) ; on ne doit pas, pour une poésie mal-aimée, ostracisée, être condamné à l’anonymat, au silence, aussi platement, aussi inconsidérément, aussi faussement que je l’ai montré (j’aurais aimé en montrer plus, davantage de mauvaise foi et d’inanité conceptuelle, mais j’ai choisi de dire ce que je sais, au lieu de dire tout ce que je sens).
« Nous avons lu dans vos textes de très belles images, de beaux vers, de belles idées »
C’est déjà pas si mal pour un œil fatigué, qui connaît la laideur, un déjà-trop-vieux corps, déboussolé, un mauvais esprit lézardé qui ne s’est redressé qu’au fil du temps et au prix d’efforts qui ne contredisent pas la vie. Il existe forcément des poètes, revenants ou brisés, qui profiteront de leur poésie pour se soigner d’un dérèglement des sens.
Je demande plus d’attention, plus d’ouverture, plus de naturel que beaucoup d’entre vous, poètes contemporains, n’en montrez à la poésie contemporaine de un à dix-sept mètres. Et si elle n’est pas assez haute, ou pas assez profonde pour vos échelles, dites-le lui.
Novembre 2021
David Rolland