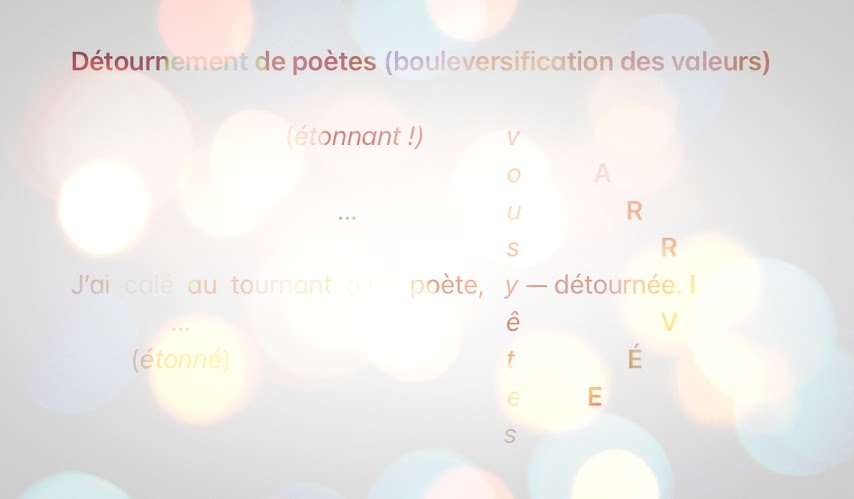
David Rolland : « Vous en avez rêvé, un lecteur l’a fait : il s’agit d’un livre, de 9 pages. Merci l’auteur. » Impératif de circonstance : Agis de telle sorte que tu traites le boumeur aussi bien dans Dieu que dans le Dieu de tout autre jamais simplement comme un moyen mais toujours et en même temps comme une fin, un destin et de bon cœur.
jeudi 10 novembre 2022
dimanche 6 novembre 2022
La démence collective
 |
| René Descartes (1596-1650), d’après Frans Hals |
La culture et l’éducation de France a la haine de la vocation. Elle la démoralise, la harcèle, la violente. Sauf si la vocation parvient à décrocher les diplômes que les mentalités attribuent faussement au « mérite ». Mais comment un jeune harcelé et agressé avec des coups, des préjugés et la haine de ses origines peut-il croire que l’égalitarisme le protège ? Face à l’acharnement qui le frappe quand il réussit, car la perversion y voit son échec, comment ce jeune peut-il s’intégrer ? Contre la perversion qui le saccage dès qu’il échoue, car l’acharnement y voit sa réussite, pourquoi ce jeune gêne-t-il ? La seule réponse qu’on lui donne est celle-ci : « Parce que ». C’est la réponse d’un enfant de classe de maternelle peu éveillé. Est-ce l’idéal français qui s’exprime là ? L’idéal infantilisant ? L’idéal, son concept, ne serait donc qu’une infantilisation à laquelle on devrait renoncer ? Dans ce cas, la réussite du peuple de France serait un triomphe. À moins que le gâtisme allié à la putasserie de la volonté, triplées d’une perversité qui déserte l’esprit dans l’espoir de prostituer la matière, la « matière » étant dans notre système de volailles :
1. la jeunesse.
2. la femme, de la fille aux grands-mères.
a. les gaulois convaincus,
b. les réincarnés forcenés,
c. les colériques qui ne cherchent la foi qu’en mentant,
d. les sectaristes qui tiennent l’inverse pour chose possible et le néant pour une évidence sur laquelle ils ne reviennent pas. Un instant dure pour eux une zeptoseconde (« c’est 10 puissance moins vingt et une seconde ! Il s'agit d'un temps extrêmement court : un billionième de milliardième de seconde » — France Culture, dans Le Journal des sciences, le 19 octobre 2020). Pour ces sectaires les instants sont nombreux, mais leur vie, relativement parlant, leur paraît plus courte, peut-être, parce que moins riche d’une vérité qui sert la vie, qu’à ceux qui acceptent les différences cultivées, mais que la culture de la division ennuie. Bien que l’ennui soit une brique de base qui importe à toute culture d’élévation, personne de sensé ne daigne tolérer que la culture se passe dans l’ennui imposé, à des vivants, par des sectateurs du culte de la mort. L’exclusion programmée et systématique d’une minorité jalousée se nomme soit racisme, soit sexisme, soit nihilisme. Le nihilisme, dans ce cas précis, peut se nommer : favoritisme pour élever au pouvoir les décadents, tout en provoquant la déchéance des individus les plus sains, pour improviser un truc, une bricole qui humilie l’Allemagne post-nazisme pendant… « Pffffff ! Je sais pas ? J’ai oublié. Bref. » Cette logique est celle de la croix gammée, ou de la svastika, il suffit de penser à ce symbole honni et proscrit pour apprécier la chute des uns quand les autres s’élèvent, par la volonté de fer de l’injustice : au croisement, au centre, c’est l’oeil du néant, de la rencontre, criminelle et sanglante, stupide et sans âme, indifférente, humiliante.
Combien de pertes sur l’inconscience dans ce système de fous malsains, limités au jugement, à la réputation et aux caprices ? La seule chance de la jeunesse de France sera que cesse d’agir en France la haine de la chance de l’autre. L’amour, le couple, la réussite, la famille et la vie ne poussent que sur un sol où la chance est respectée.
Un nihiliste des plus actifs au service de la pourriture est mort. Un mort en moins ici a enfin trouvé la vie. Il s’appelait Noël, il avait femme, enfants, salaires, épargne, vie bourgeoise, droits fondamentaux, privilèges de classe, j’en passe.
Ils disent : Dieu et le père Noël, idem. Autant dire : l’amour dont ils privent ce qu’ils marquent du néant.
Suis-je un philosophe ? Est-ce que je n’exagère pas, mon diagnostic du mal ne souffre-t-il pas de quelques approximations, mon discours peut-il prétendre à mériter le titre de la vérité ? Depuis que je suis un écrivain, je n’ai jamais trahi, dans mon métier, dans mes écrits, la vérité, la bonne cause de la vérité. Cette bonne cause a deux titres. Le premier titre est l’autre mot pour dire la bonne cause. Le deuxième titre est le terme le plus exact pour évoquer l’être de la vérité. Tous les deux y travaillent, c’est tout un. Les êtres vont toujours par deux.
vendredi 10 septembre 2021
LECTURE : Jacques Prévert vu par Michel Houellebecq
 |
| Jacques Prévert, 1961, dans le film Mon frère Jacques, Pierre Prévert (source Wikipedia ©Jacqueline Prévert) Creative Commons |
Jacques Prévert est un con,
Interventions, Flammarion, 2020
Trop de grands cons ont pignon sur rue dans les Lettrespour que je n’en fasse la lecture aux toilettes...me disais-je, bien accroché à ma tablettelisant, lorsqu’un nouvel effort fit reparaître...Interventions 2020 de Houellebecqoù, paraît-il, « Jacques Prévert était un con » !Je cite : « Jacques Prévert est quelqu’un dont onapprend des poèmes à l’école »... Est-ce que qu-elque style le gêne dans l’enseignement ?La poésie n’est-elle réservée qu’aux grandscons d’une époque dont Houellebecq est le nom ?Tout est bon dans l’école, et la bonne paroleet d’y retourner apprendre la concision :Le poète Prévert est appris à l’école
— II —
SYNTHÈSE
Houellebecq a écrit : Prévert était un conLe poète Prévert est appris à l’écoleIl aimait les oiseaux, les fleurs, les vieux symbolesIl était plutôt libre et j’ai plutôt raisonMoi, j’ai honte à y lire ses bourgeois cochonsses jolies filles nues sorties des années follesses bambins immoraux nés des rues, nés des violsses curés négateurs, impeccables félonsLa critique historique infirme ses clichésL’intelligence aussi, qui manque aux débauchésà tous ceux partisans de la FraternitéPrévert en était un, c’était un libertaireÀ sa littérature des facilitéson peut préférer Robespierre — ou Baudelaire
jeudi 29 avril 2021
LECTURE : Quart livre des reconnaissances, de Jacques Réda, LE BON POÈTE
Quart livre des reconnaissances, Jacques Réda, Éditions Fata Morgana, 2021
Réjouis-toi, poésie !
Jacques Réda publie.
Le Quart livre des reconnaissances est l’un des rares livres, l’un des seuls, en 2021 et au-delà du temps, qui réveillent le lecteur de poésie égaré ou déçu par la production moderne.
Le Poète, fidèle à sa Muse, a su marier la forme et le fond dès les premières pages, qui s’ouvrent sur les Fragments d’une épopée du mètre avec la suite Le Roland sérieux :
I
Décasyllabe est le vers féodal
Du preux qui tient ferme sa Durandal
Entièrement composé de vers de dix syllabes et traitant des origines de la langue littéraire française, ce poème fourmille d’intentions, de trouvailles et de rimes, d’allusions et d’évocations historiques qui en font, outre une parodie tardive de la chanson de geste, une lecture chantante, une coupe légère qui accueille en elle les siècles et les esprits, sans imposer leur poids. Le geste donc, est large, ouvert, bienveillant.
dimanche 7 février 2021
CRITIQUE : « Que reste-t-il de la poésie ? », livre de Dana Gioia
Dana Gioia : Que reste-t-il de la poésie ?
Sous la forme badine d’un debriefing dont les Américains ont le secret, l’auteur dénonce la spécialisation de la poésie, désormais affiliée aux cours universitaires de création littéraire. Donnés par des poètes institutionnalisés, pour un public toujours plus confidentiels de poètes et de moins en moins lus par le grand public, la poésie, selon l’auteur, se rumine dans l’entre-soi. « La poésie américaine est désormais l’apanage d’une coterie. » (Incipit, p. 7) Les revues n’intéressent plus que des poètes, eux-mêmes auteurs et lecteurs de poèmes, à peine le public cultivé. La professionnalisation des poètes fait de la poésie l’intérêt d’une petite communauté qui n’hésite plus à honorer les siens, parfois au détriment de la qualité intrinsèque des publications. Ainsi, la critique sincère n’étant guère plus produite, mais systématiquement bienveillante, on entortille la poésie dans le sirop de la connivence. La culture populaire tient la poésie pour morte, puisque dévitalisée, coupée de ses racines existentielles.
Sans doute l’essor d’Internet a permis, depuis la publication de ce texte, de transmettre potentiellement la poésie à un plus grand nombres de lecteurs.
Il manque sans doute aussi à cet essai des développements qui atténueraient son tour un brin caricatural, car s’il vise juste et touche souvent sa cible, ce tour d’horizon laconique, flegmatique, laisse un champ dévasté par le pessimisme de la concision, un pessimisme trompeur dans la mesure où tout semble normal si l’on n’y prend garde, tant l’aperçu semble impeccable. La synthèse critique a quelque chose de lénifiant malgré son coup pamphlétaire, qui semble nous dire : « Dormez braves gens, c’est la poésie qui passe... au prochain tour elle meurt ! »
L’auteur, qui avec beaucoup de sang-froid prétend dominer son sujet, verse dans une analyse qui pèche par une vision trop verticale du pouvoir et du cercle des poètes universitaires et institués, tandis qu’une enquête plus étendue, un road-trip moins confiné qui explorerait les grands espaces poétiques et profonds de sa terre d’Amérique, l’aurait sans doute mené à trouver, du moins à chercher la poésie ailleurs que dans les seuls lieux qui l’estampillent. Ce défaut confère à sa critique un air aseptisé qu’il est le premier à dénoncer dans le monde universitaire. Mais sa brièveté ne passe pas à côté de l’essentiel. Dana Gioia est également conscient du rôle que doit jouer la poésie du langage et ceux qui la font : donner, au-delà des classes et des assignations, un sens à nos existences. Conscient de l’importance du langage dans la culture, il se prononce contre l’élitisme et le repli sur soi, en faveur d’une poésie qui se communique et se transmet.
L’essai se finit sur des propositions selon lui à même de sauver la cause de la poésie, en la faisant battre dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Il prône donc la lecture publique, par les poètes, d’autres poètes qui leurs soient inconnus ; le décloisonnement des arts, en invitant notamment la musique à participer aux événements poétiques ; des critiques et articles aussi sincères que possibles, sous la plume des poètes, dans de multiples publications non spécialisées ; un appel à exclure de toute anthologie poétique les intérêts partisans ; et enfin, une proposition qui, contrairement à toutes les autres, va à rebours du sens communément admis par nos spécialistes français de poésie (qui depuis l’avénement du web ont largement mis à profit les autres propositions, le plus souvent en reproduisant les mêmes travers incriminés) : que prévale, en classe, la récitation sur l’analyse, en partant du principe que « les poèmes sont faits pour être lus, appris et récités » (p. 56). Cette proposition, qui a le don de me plaire, épouvantera peut-être des poètes et poéticiens français encore en vie, qui se sont époumonés à refuser à la poésie la chance qu’on la récite. Mais Dana Gioia va encore plus loin, puisqu’il ose ce qui relève du blasphème, même ici, en affirmant que le « plaisir des mots » participe de la poésie, et même, au sujet de l’oralité : « Il se pourrait qu’elle détienne aussi les clés de l’avenir de la poésie », conclut-il. Il y a donc des raisons d’espérer.
mercredi 18 septembre 2019
Éperons de la critique : notule poétique
| Arthur Rimbaud, 1872 © Étienne Carjat - Wikipedia |
Autour de la poésie : la gnose-la-prose-la-glose. La critique et la poétique, la métacritique et la métapoétique, les commentaires, se rendent pratiquement incritiquables, puisqu’ils prétendent englober le tout dans le phénomène « poésie », le subsumer en lui-même, en logoïsant le monde. Chacun, devant ce discours, n’a qu’à se taire, ou lui emboîter le pas, avec pour résultat qu’aux grandes approximations on ajoute de l’imprécision, au grand flou son vague témoignage. Le commentaire assèche, la critique décrépit, et, à rebours, la gnose-la-prose-la-glose révèlent leur propre aridité. La première victime en est la poésie : elle est surplombée, de toutes parts, par de grands esprits, de grands lecteurs, de grands critiques et de grandes injonctions. C’est l’ère du méta-individualisme où règnent les principes, les classes à l’infini. La vie est autre chose... du court, du dense, du beau, du fou. En mettant le doigt sur le « je », la distinction apparaît, d’où la permanence du vers et de la rime.
J’en écrirai encor, des vers !
Comme Verlaine et Baudelaire...
J’en ferai encor, des affaires !
Comme Arthur Rimbaud en enfer...
et quelques fabuleux blasphèmes
de ceux qui vouent à l’anathème
celui qui en fait des poèmes
prélude à de nouveaux problèmes...
La jeunesse (brave jeunesse)
dévorante, feignante, ogresse,
agglutinait les sons (ô graisses)
déjà bien avant que je naisse
et se mentait sur tout (je mens…)
ce qui a pour nom « sentiment »
sans égratigner le tourment
que j’opère... Adieu charlatans !
J’aurais mieux fait de m’engager
dans le commerce et bien manger
au lieu de « métalangager »
pour devoir mes talents gâcher !
Qu’attend le monde d’un poème
sinon qu’il soit d’amour bâti
avec des mots pour le porter
sous le soleil vers l’éternel ?
Je m’en vais même si je t’aime
C’est décidé je suis parti
Non n’essaie pas de me chercher !
Je suis au-delà du Sahel...
vendredi 11 janvier 2019
CRITIQUE LITTÉRAIRE : critique des critiques philosophiques

mardi 21 août 2018
Poète, que veux-tu ?
 |
| Paul Celan (1920-1970) |
LE CLIENT : Dieu a fait le monde en six jours, et vous, vous n’êtes pas foutu de me faire un pantalon en six mois. LE TAILLEUR : Mais, Monsieur, regardez le monde, et regardez votre pantalon.
Le monde et le pantalon, 1945, Samuel Beckett
À quoi bon des poètes ? À quoi bon des maisons d’édition de poésie ? À quoi bon, si je ne peux jamais lire une nouveauté poétique qui rime à quelque chose ? Qui rime avec quelque chose ! S’il ne m’est jamais donné de lire ce que j’aimerais vivre écrit d’après un vivant ? Qui rime avec quelqu’un ! Laissons de côté la chanson populaire, il s’agit ici d’autre chose. Je viens de passer une petite heure à farfouiller dans les rayons de poésie d’une petite librairie, à la recherche de recueils de poètes contemporains. Jamais je n’ai pu découvrir, pas plus d’un quart d’instant, sans que la faute en soit aux libraires, la moindre harmonie, la moindre envie de musique, la moindre simplicité de dire, non pas celles des mots que nous pouvons tous avaler, mais celle du monde, non pas le monde, mais celui de tous ces poètes. La rime est un principe, l’affaire est entendue. Je ne peste pas contre le manque de principes, mais contre l’absence de tout principe poétique, qui ruine l’édition de poésie et la lecture avec.
Qu’il m’est pénible d’ânonner de l’esprit et de la voix, de trébucher sur tant de briques malfaisantes, sur tant de voix naturelles, sur tant de balbutiements abscons, sur des paysages dont l’aridité, la minéralogie, la virtualité, encombrent l’époque et occupent si peu le temps d’une lecture, que je me sens contraint et forcé de vitupérer, de philosopher. Si toutefois la diversité régnait véritablement ! Mais ce qui a pour nom diversité en poésie contemporaine n’est que la diversité du monde. La vie poétique, dans la plus simple expression de sa nécessité, de sa nudité, peut attendre encore longtemps. Dans les grimaces de ces aimables modérations de comptabilité de la langue du monde, on vous fait tantôt sentir que, vous, ce n’est pas assez naturel, tantôt pas assez travaillé ; tantôt c’est votre représentation qui est obsolète, tantôt c’est le sens qui vous fait défaut ; puis retournabilent farcir des pages par centaines dans leur technique bavoir de virtuquosité.
Côté édition, les choses sont pires. En musique, jamais les éditeurs et les amateurs de musiques sérielles n’ont empêché le moins du monde la pop et le rock de paraître, d’être diffusées et appréciées, ni la musique baroque de renaître. En poésie du monde, nulle âme ne semble vivre, qui survive au son du battement de la trique Métrique, nulle conscience qui, croirait-on, ne pulse ni ne s’arrime en vertu de la Rime. La rime, pour peu qu’elle rapproche les mots du poème de la vie du poète, est le principe le plus fiable en poésie, avec la métrique, que le vers soit libre ou non est d’importance secondaire. Se souvient-on parfois de la délicate parole de Mozart enfant ? « Je mets ensemble les notes qui s’aiment. » Que la vie poétique ne soit pas heureuse en amour, cela arrive. Que les mots d’amour ne viennent pas facilement au poète vivant, cela arrive aussi. Mais que plus jamais les mots et la vie poétiques ne riment, ne coïncident, ne servent ni la représentation, ni le sens, ni aucun poème, ce fait est un fait d’une incongruité indéfendable. Que d’aimables poètes préfèrent écrire des poèmes sériels au lieu de rimes, en raison de la méconnaissance que nous avons tous des fondements du langage, de la raison, du logos, autrement dit en raison d’un manque de religiosité, de foi rationnelle, ne me poserait pas le moindre petit problème si seulement je ne me sentais pas ainsi contraint sous le régime de la botte à ne lire que des grands morts et à proférer des imprécations contre d’illustres inconnus qui ont pour eux force, empire, et tyrans célèbres.
Tous les sanglots vivants du monde iront à l’Univers.
Après tout, j’ai choisi la rime et le vers. Eux les rejettent. Pourquoi ?
Après Auschwitz, Paul Celan a formulé un principe en poésie, celui de survivre : « Rester là, tenir, dans l’ombre / de la cicatrice en l’air. » (Choix de poèmes, p. 233). Après l’enfer des camps de la mort, avec la mémoire de l’anéantissement, Celan, imprégné de mystique juive, ne pouvait pas comprendre que Dieu eût permis le crime des crimes. À ce jour, je ne crois pas qu’il puisse exister un seul athée rationnel pour qui l’Holocauste n’entre pas en ligne de compte dans sa conviction d’être un athée. On vit avant ou après, mais il n’y a même plus ni avant ni après, l’événement submerge l’histoire et constitue la mémoire des mémoires. Personne au monde n’est ni ne sera rescapé de l’histoire nazie. « La mort est un maître venu d’Allemagne » (Fugue de mort, Paul Celan). Dans Psaume, il nomme Dieu de façon ambiguë et ambivalente, il l’appelle « Personne » : « Loué sois-tu, Personne. / Pour l’amour de toi nous voulons / fleurir. / Contre / toi. » Poète religieux, né en 1920, Paul Celan voulut survivre contre Dieu après Auschwitz. Il se donna la mort le 20 avril 1970. Il n’avait pas besoin de rimes pour poétiser. Dieu était sa voix et l’objet de sa colère. Nul poème n’a besoin de rimes pour être poésie. Mais à quoi rime une vie poétique de nos jours, si elle n’est pas plus dangereuse que le quotidien et l’atome, si la poésie n’est jamais écrite et publiée qu’en prose ? Mais où diable est-il encore question de Dieu dans la poésie ? Paul Celan serait-il, dans plusieurs consciences poétiques dérangées haut placées, le poète qui aurait tué Dieu et Personne, pour une postérité sans raison ni vérité ?
Je me sens absurde et dissipé, avec mes questions difficiles. Assez récemment, j’ai trouvé un recueil de sonnets de Didier Malherbe publié au Castor Astral : Escapade en facilie. Les subtiles et innombrables variations de la facilité y sont déclinées dans des sonnets qui touchent la cible parfois, mais qui pour certains souffrent de quelques maladresses de style. Les sens multiples que peut revêtir la facilité y sont brillamment illustrés, mais l’exercice de style a ses limites. Gonflé de cet artifice, le recueil ne m’a pas paru des plus véridiques, à moins que l’auteur n’ait rien voulu d’autre que montrer, non sans esprit, la palette vivifiante de ses facilités à lui. Un terme choisi sans bonheur car, à mon sens, l’auteur et son recueil ne peuvent manquer de se distinguer au milieu de la masse cacophonique de la poésie sérielle, en arborant l’étiquette facile. Je manque peut-être d’humour, mais l’orchestration pataude de l’édition poétique en France ne m’aide pas beaucoup. Il me semble que cette tentative de facilité ne soit même qu’une dissonance, qu’un pouet honorable parmi de violents efforts ; mais qui sait de quel prélude il sera le héraut ?
Si l’humour consistait à exclure de l’esprit éditorial les poètes différents, on relèverait immanquablement leur différence, avec ironie, lorsqu’ils s’incluent d’eux-mêmes. C’est pourquoi l’autoédition est une preuve d’ironie de la part d’un auteur, et la publication une forme d’esprit de la part d’un éditeur, et je m’étonne, à bon droit, de ne jamais recevoir la visite du grain de sel du monde hospitalier. Peut-être par ironie ?
L’humour errant comme poésie ou soleil disperse des rayons le souffle de rareté.



