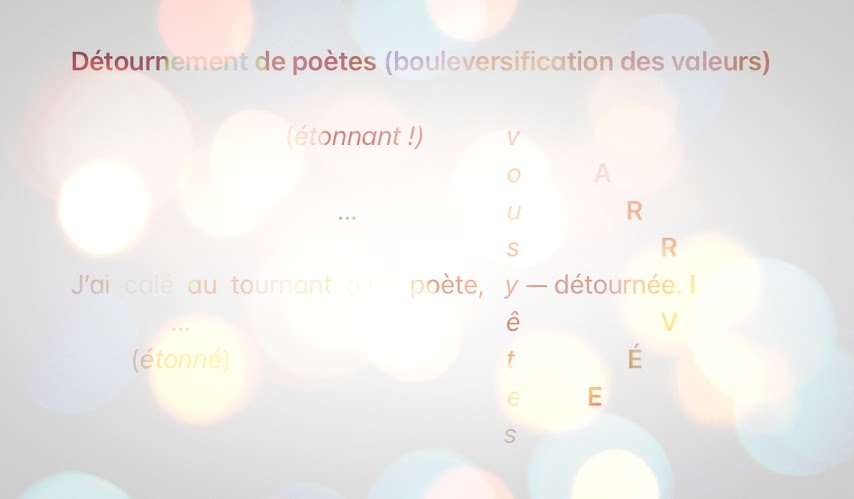|
Estampe Denys Le Tyran, Honoré Daumier (1808-1879) |
II. La dette et le tyran
Court essai d’harmonie
La dette et le tyran : voilà, pourrait-on dire, comment nombre de poètes contemporains considèrent la conception de la poésie qu’ils qualifient de « classique ». La dette et le tyran, autrement dit : le vers et la rime. Eux se disent « libres » et affranchis, en bons démocrates du verbe. Mais il y a, à l’origine de leur jugement de valeur sur la poésie, une ou deux erreurs d’optique.
La première erreur est facile à deviner. Ils se disent poètes contemporains. Pourtant, quand l’un des leurs emploie le vers et la rime, ils nomment sa poésie « classique ». Mais non : elle est forcément contemporaine puisqu’elle émane d’un de leurs contemporains, sans quoi elle — ou son auteur — serait posthume. L’épithète de « contemporain » ne peut évidemment s’appliquer qu’au temps qui voit naître le poète et son œuvre, jamais au style de sa poésie. La manie d’envisager l’histoire de la poésie remplie de courants et de mouvements commodément intemporels et discriminants est peut-être à l’origine de l’appellation « classique », mais elle est anachronique et inopérante pour dire sérieusement ce qui s’écrit aujourd’hui, quel qu’en soit le style.
La seconde erreur est plus fine. La poésie dite contemporaine se veut libérée des contraintes de l’harmonie. C’est pourquoi elle se dit libre ou « vers-libriste ». Cette dernière expression reconnaît, volontairement ou involontairement, que la poésie ne s’est pas émancipée des vers, pour une bonne raison : cela lui est impossible. Le minimum syntaxique du poème reste le vers. Un seul mot peut suffire à former un vers. Le vers est le strict nécessaire du poème, son « minimum syndical », sans aborder ici la capacité de la poésie à embrasser la page, quand le poème s’écrit en prose.
La poésie dite « libre » et la poésie dite « classique » ont en commun la particularité qu’un poème, s’il est composé de vers, ne joue pas le jeu de la prose, ni dans une certaine mesure, plus restreinte, celui de la page. Un poème est toujours libre, soit il est tombé sur le papier, soit il s’est laissé attraper, mais chacun sent qu’il est libre de s’envoler : chant, murmures, récitation, silence. Ce fait, pour peu que l’on se réfère à un poème de n’importe quelle époque, est, il me semble, immanquable. Pour le dire plaisamment : le texte du poème, à l’échelle du livre, économise de l’encre et, en contrepartie, gaspille du papier. Il ressemble ainsi à un oiseau tombé sur la page, ou au nid auquel il retourne pour nourrir ses petits. Cette image vivante du poème tranche avec la fluidité liquide de la prose qui remplit les pages tout en étant contrainte sans mal au format du livre. La prose s’épanche. Les poèmes, plus mesurés, contraignent toujours tant soit peu le livre, parce qu’ils ne l’épousent qu’au prix de l’acceptation, par le public, d’une forme qui laisse un vide. Bien que ces formes soient traditionnellement reconnues aujourd’hui, elle sont en apparence plus frugales qu’un roman. En apparence seulement, car la poésie libre, au sens où nous allons l’expliquer, est porteuse d’une densité et d’une exigence d’harmonie et d’équilibre qui contrebalancent sa relative avarice.
Les vers donnent au poème son rythme, régularité et irrégularités, ils équilibrent le flot millénaire du fonds de la poésie, qui ouvre chaque poème sur le flot sauvage de la parole, ancestrale, immémoriale, mais toujours présente. Il importe, outre l’originalité du poème et la sincérité du poète, que les vers entrent en résonance avec ce fonds et cette parole, aux confins du verbe, jusqu’à la dimension transcendante de l’existence, car le poème harmonise alors à la fois le langage commun et ce qui lui fait écho ; il prend son sens à cette place où l’harmonie équilibre le poème en lui-même et hors de lui-même, depuis son dedans et vers l’ailleurs, toutes raisons d’être, comme une éponge absorbante qui boucherait l’espace et filtrerait la substance intelligible et sensible qui passe entre l’infini et la vie.
Les rimes sont des points nodaux d’équilibre et de déséquilibre. Elles viennent aider les vers à continuer leur chemin, ou torpillent quelque peu leur travail : les rimes sont des prises de risques. Mais elles ne devraient pas forcer le sens des vers en se souvenant trop des autres poèmes, ni servir aux vers de fourre-tout, car c’est à cette condition qu’on pourrait parler de tyrannie. Je n’ai jamais bien compris, en voyant certains brouillons d’auteurs du passé, comment les rimes pouvaient être disposées avant le travail des vers sans les tyranniser, comme si la fin justifiait les moyens, ou comme si les rimes symbolisaient un passage obligé des signes, au sujet desquels le poète ne pouvait pas transiger (peut-être s’agissait-il de défricher un champ autrefois inexploré de la création). Il est beaucoup plus amusant aujourd’hui de se lancer dans l’écriture d’un poème en l’improvisant, par conséquent en s’y livrant avec la foi et de manière majoritairement linéaire, comme dans l’existence, avec le sentiment d’une prise de risque alliée à un effet de surprise que le poète est le premier à découvrir. Il y a une vigilance à maintenir en alerte quand on compose un vers, mais il y a double vigilance à observer quand on en vient à la rime. Elle peut laisser fuiter le vers jusqu’au vers suivant, comme elle peut le catapulter quelques vers plus loin, ou dynamiser la scansion (en utilisant le rejet, notamment), en injectant un déséquilibre ou une force supplémentaire.
Les rimes harmonisent elles aussi le poème, pas à la manière des vers qui brassent le texte et le contiennent entièrement pour l’offrir, mais comme des jalons spatio-temporels placés là pour pondérer le rythme du texte et le regard du lecteur, les éclairer de fanaux, les creuser de pièges, les fluidifier ou induire des résistances que le texte incite le lecteur à surmonter en recourant à des ruses : tantôt lire tout haut, tantôt gueuler ; tantôt le silence, tantôt chuchoter ; seul ou à deux ; en comité ou au stade ; lire de haut en bas ou de bas en haut ; foncer, revenir ; respirer.
Je parle de la dette et du tyran pour dire l’état de la poésie quand elle est dans un rapport de contrainte passive et non consentie, non éclairée, envers la parole. Seuls exemples (à ma connaissance) existant pour le décrire : le mauvais goût, la mauvaise foi et la gaucherie. C’est l’inadéquation entre le tyran qu’est l’auteur et sa dette envers la poésie, comprise comme parole véridique. Rétribue-t-il mal le fonds de la poésie, la pratique authentique du poème ? Ce n’est qu’un problème de critique, de travail et d’approche.
La rime n’est pas un tyran pour peu que le poème soit équilibré. C’est l’auteur qui fait son tyran quand il n’aime pas assez la poésie tout en l’exerçant. Pourquoi se torturer, sinon pour torturer ce qui le torture ? Je l’ai dit, le vers, la dette en poésie est inévitable, il est inévitable de s’en acquitter. Mal s’en acquitter, c’est tyranniser, c’est se cramponner maladroitement. Les rimes sont les bouts des vers, leurs fins. Elles ne sont jamais le but des vers ni le but d’un poème, dont la fin n’est pas marquée avant le dernier mot. Les rimes tyranniques sont trahies par les poètes lorsqu’ils ne les raniment ni ne les altèrent depuis des siècles, mais les reconduisent à l’identique avec leurs tares forcées.
Dans un vers, le plagiat quand il a lieu est manifeste, pour peu qu’on soit bien informé. Mais certaines rimes ont été mille fois plagiées, là réside le scandale mais là aussi la liberté de s’en défaire, puisqu’une rime peut supporter infiniment plus de plagiats qu’un vers, qui correspond à peu près à une unité de sens, tandis que la rime n’est qu’une unité d’harmonie. La poésie n’apparaît tyrannique que selon la rime (ou alors il y a plagiat, selon le témoignage attesté d’au moins un vers, un demi-vers dans le cas de l’alexandrin, la césure à l’hémistiche faisant foi) ; toutefois, la poésie peut encore et pour longtemps être libre selon la rime et selon le vers (ce qui signifie : ni radotage ni plagiat).
Le vers n’est dû et débité que s’il n’appelle pas sa raison d’être et s’il ne la contient pas davantage. Voilà, entre autres complications, pourquoi il importe de savoir compter. Il est humain et beau de vouloir sauver quelqu’un qui patauge ou se noie ; mais le minimum serait de l’aider à reprendre sa marche au lieu de le laisser pantelant sur la berge ou dans un fossé. Alors la terre nourrit le poème, les tiges et les nervures poussent librement, les rimes fleurissent puis se fanent et les vers se distribuent à la becquée ; petit à petit l’oiseau fait son nid.
La grâce d’un poème se reconnaît à la vigueur de vers si libres qu’ils sont tendus et déployés vers l’infini, en direction de l’être qui le sauve.
Quand une rime ou deux fleurissent dans l’âme d’un poète, c’est le début d’un beau poème. Quand les mêmes rimes refleurissent dans le cœur d’un lecteur, c’est un miracle et il y a lieu de s’en émerveiller.
Nos contemporains poètes ont beaucoup trop confondu la théorie structurelle et la pratique régulière, la critique et la poésie, les lois de l’harmonie et celles de l’inspiration.
Lorsque le poème est vraiment libre, la contrainte formelle est toujours possible, mais je la nomme active car elle consolide le poème seulement dans sa structure, sans le figer, en lui donnant une forme où il s’épanouit et la dépasse, la surmonte et la sublime, pour que la poésie parle suffisamment haut, suffisamment bien, pour être attendue et reprise (de mémoire ou en relecture).
Les fictions ancrées dans les esprits de nos contemporains infligent à la poésie tout autant un reproche récurrent qu’une œuvre répétitive, que résume et désigne la formule la dette et le tyran, comprise comme pétrification de la critique et de la poésie.
30 décembre 2021